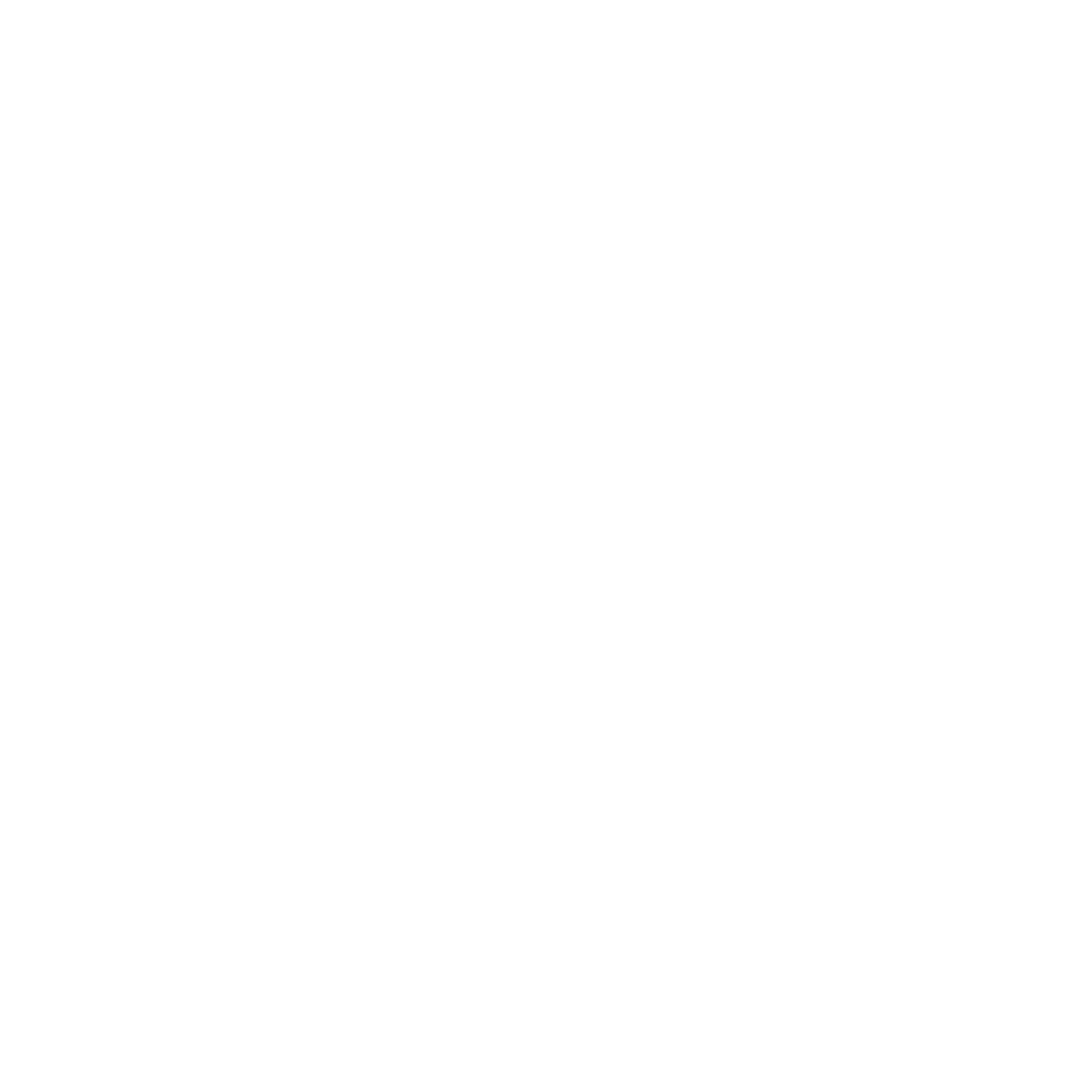Le projet en bref
L’eau comme droit fondamental et bien commun. Ce projet renforce les compétences des membres des comités locaux de gestion des aqueducs communautaires* répartis dans 7 régions : 1 urbaine et 6 rurales. Il accompagne ces comités sur deux axes principaux : 1) dans le développement de solutions durables grâce à la surveillance environnementale (collecte de l’eau, suivi qualité etc.) 2) dans la mobilisation collective afin d’influencer les politiques publiques (participation active à des réseaux locaux et nationaux, actions de plaidoyer etc.). Le projet met particulièrement l’accent sur le renforcement et la formation des femmes et des communautés autochtones, afin de préserver les écosystèmes, défendre leurs droits et gérer durablement les ressources en eau.Régions d’intervention : Buenaventura dans le Valle del Cauca, San Martín de los Llanos dans la sous-région Ariari-Meta, Quinchía-Risaralda, Tasco-Boyacá dans le Páramo de Pisba, Bogota région rurale, Nariño et Cauca dans les régions du Sud du Pacifique colombien.
Population concernée :
Directe : Environ 11’620 personnes, dont 6’965 femmes
Indirecte : Environ 407’497 personnes
Durée du projet : 3 ans, du 01.05.2025 au 30.04.2028
Coût du projet : CHF 394’273 sur trois ans
* L’aqueduc communautaire permet de capter et de transporter l’eau d’un lieu à l’autre pour alimenter une communauté (groupe de personne, village, quartier, etc.) en eau potable ou irriguer les terres. L’aqueduc assure un approvisionnement régulier en eau dont la gestion, l’entretien et la qualité est contrôlée par un comité de personnes issues de la communauté et non par une entité publique ou privée. Ce modèle fonctionne en parallèle ou en complément du service public et repose sur une gestion collective et solidaire assurée par la communauté.
La Colombie est l’un des pays les plus riches en biodiversité et en ressources hydriques au monde. Cependant, le pays est marqué par de profonds défis environnementaux et sociaux. Dans les zones rurales et périphériques, l’accès à l’eau potable est gravement menacé par la privatisation, l’extractivisme minier, l’agriculture intensive, la déforestation et la pollution, qui entraînent une dégradation accélérée des écosystèmes. Le changement climatique accentue encore ces pressions.
Les populations rurales, autochtones et afro-colombiennes sont les plus touchées : elles subissent un accès limité à l’eau et une gestion inefficace des ressources hydriques. Les aqueducs communautaires, gérés directement par ces communautés, assurent souvent l’approvisionnement là où l’État est absent.
Or, ces structures essentielles se heurtent à de nombreux obstacles : manque de reconnaissance légale, faibles ressources, pollution accrue et conflits liés à l’usage de l’eau.
La pénurie d’eau, combinée aux inégalités sociales et économiques accroît la vulnérabilité des communautés et fragilise la cohésion territoriale. Celles-ci ont besoin de renforcer leurs capacités techniques, environnementales et juridiques pour gérer durablement leurs ressources, surveiller les pollutions, défendre leurs droits et participer activement aux processus de décision.
Au fil de ses phases précédentes, le projet a permis de préparer le terrain pour la reconnaissance juridique des aqueducs communautaires, de renforcer les capacités locales en plaidoyer et gestion de l’eau, et de créer des outils innovants, comme la Surveillance Environnementale. Ces acquis ont ouvert la voie à une autonomie progressive des communautés et ont favorisé la mise en place d’espaces de dialogue avec les institutions publiques.
Les populations rurales, autochtones et afro-colombiennes sont les plus touchées : elles subissent un accès limité à l’eau et une gestion inefficace des ressources hydriques. Les aqueducs communautaires, gérés directement par ces communautés, assurent souvent l’approvisionnement là où l’État est absent.
Or, ces structures essentielles se heurtent à de nombreux obstacles : manque de reconnaissance légale, faibles ressources, pollution accrue et conflits liés à l’usage de l’eau.
La pénurie d’eau, combinée aux inégalités sociales et économiques accroît la vulnérabilité des communautés et fragilise la cohésion territoriale. Celles-ci ont besoin de renforcer leurs capacités techniques, environnementales et juridiques pour gérer durablement leurs ressources, surveiller les pollutions, défendre leurs droits et participer activement aux processus de décision.
Au fil de ses phases précédentes, le projet a permis de préparer le terrain pour la reconnaissance juridique des aqueducs communautaires, de renforcer les capacités locales en plaidoyer et gestion de l’eau, et de créer des outils innovants, comme la Surveillance Environnementale. Ces acquis ont ouvert la voie à une autonomie progressive des communautés et ont favorisé la mise en place d’espaces de dialogue avec les institutions publiques.
À long terme, le projet vise à renforcer les organisations communautaires et leur mise en réseau, en leur apportant un soutien technique, financier, juridique et institutionnel. L’objectif est d’assurer une gestion de l’eau considérée comme un bien commun, en privilégiant des approches basées sur la justice environnementale, les droits environnementaux et collectifs, ainsi que sur l’égalité de genre.
À court terme, ces organisations communautaires de gestion de l’eau adoptent des pratiques durables et égalitaires dans la gestion des ressources naturelles. Les femmes y occupent un rôle central, notamment dans les initiatives solidaires et communautaires de défense des territoires. Par ailleurs, ces organisations influencent activement les politiques publiques, garantissant ainsi le respect et l’exercice des droits environnementaux.
Le projet s’articule autour de trois approches :
- Recherche-action participative et suivi environnemental communautaire, pour impliquer les communautés dans la production et l’analyse de données.
- Renforcement de la participation et de l’autonomisation des communautés, à travers des outils favorisant la prise de décision collective.
- Travail en réseau et initiatives solidaires, pour mutualiser les expériences et créer des alliances locales, nationales et internationales.
Cette démarche repose sur la combinaison des savoirs locaux et scientifiques, la participation active des femmes et une gouvernance communautaire de l’eau.
À court terme, ces organisations communautaires de gestion de l’eau adoptent des pratiques durables et égalitaires dans la gestion des ressources naturelles. Les femmes y occupent un rôle central, notamment dans les initiatives solidaires et communautaires de défense des territoires. Par ailleurs, ces organisations influencent activement les politiques publiques, garantissant ainsi le respect et l’exercice des droits environnementaux.
Le projet s’articule autour de trois approches :
- Recherche-action participative et suivi environnemental communautaire, pour impliquer les communautés dans la production et l’analyse de données.
- Renforcement de la participation et de l’autonomisation des communautés, à travers des outils favorisant la prise de décision collective.
- Travail en réseau et initiatives solidaires, pour mutualiser les expériences et créer des alliances locales, nationales et internationales.
Cette démarche repose sur la combinaison des savoirs locaux et scientifiques, la participation active des femmes et une gouvernance communautaire de l’eau.
- La durabilité environnementale et l’équité de genre : Soutenir l’empowerment des femmes, renforcer la surveillance environnementale et consolider les réseaux communautaires de gestion de l’eau.
- La gestion des conflits liés à l’eau et les droits communautaires : Identifier les conflits environnementaux, accompagner les communautés dans le dialogue avec l’État et promouvoir la justice environnementale.
- Le renforcement des capacités des communautés locales : Développer leurs compétences et connaissances pour gérer durablement l’eau, surveiller la pollution et garantir un accès équitable à la ressource.

Notre partenaire local :
ENDA Colombia (Asociación Sostenibilidad, Equidad y Derechos Ambientales) - ONG basée à Bogota et initiée en 1983 afin de promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement. ENDA contribue à l’amélioration de la qualité de vie des populations vivant en zones urbaines précaires et en zones rurales.
Depuis 1998, nous co-construisons des projets autour de deux axes majeurs d’emp’ACT : la justice environnementale et l’accès à l’eau et l’empowerment des femmes.
Depuis 1998, nous co-construisons des projets autour de deux axes majeurs d’emp’ACT : la justice environnementale et l’accès à l’eau et l’empowerment des femmes.